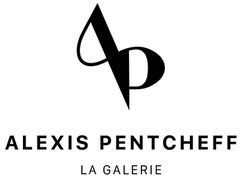Emile Othon Friesz naît au Havre le 6 février 1879. Malgré les réticences de son père navigateur, la mère d’Othon Friesz finit par céder aux demandes incessantes de son fils et l’inscrit à l’école des beaux-arts du Havre dès l’âge de treize ans. Il y suit les cours de Charles Lhuillier, qui jouera un rôle essentiel dans le développement de son œuvre, aux côtés de son ami Raoul Dufy puis rencontre George Braque qui, lui, est élève aux cours du soir dispensés par Courchet.
Il reçoit une bourse municipale en 1897 et continue son apprentissage à l’École des Beaux-Arts de Paris. Il entre alors dans l’atelier de Léon Bonnat, peintre réaliste académique, qui ne semble pas exercer une grande influence chez le jeune Othon Friesz. Dufy, toujours, l’y rejoint en 1899. Friesz se lie d’amitié avec les élèves de Gustave Moreau parmi lesquels Manguin, Marquet, Matisse et plus tardivement Camoin. A défaut de son enseignement, c’est au Louvre que Friesz puise sa plus grande inspiration. Fasciné par le groupe des impressionnistes, il rencontre Guillaumin de trente-huit ans son aîné, chez qui il passe l’été en 1901, puis Pissaro l’année suivante.
En 1903 l’artiste participe pour la première fois au Salon des Indépendants, puis au Salon d’automne en 1904 et n’entre pas encore dans la «cage aux fauves» de 1905 dans laquelle se trouvent une grande partie des élèves de Moreau. A la recherche d’une synthèse entre modernité et tradition, il ne s’affranchit que tardivement des préceptes impressionnistes déliquescents.
C’est durant l’été 1906 que les premiers accords fauves apparaissent. Friesz séjourne alors à Anvers avec son ami George Braque et se livre à des expérimentations plastiques inédites sans pourtant se libérer complètement du naturalisme de l’impressionnisme. La couleur pure, utilisée par Braque au service de l’espace pictural, n’est pas encore totalement intégrée dans l’esprit de Friesz qui s’approche plus timidement de cette peinture franche et révolutionnaire. Néanmoins, ses tableaux exposés au Salon d’automne de 1906 dans la salle III, celle de Matisse, Manguin, Marquet, Derain, Vlaminck, Camoin, Girieud et Van Dongen, démontrent une réelle volonté d’affiliation au groupe. Durant l’hiver 1907 Friesz voyage seul à Honfleur. Là bas, la couleur donne enfin le ton et la forme.
L’apogée fauve, si ce n’est de toute son œuvre, s’opère à l’été 1907 lors de son séjour avec Braque sur la côte méditerranéenne à la Ciotat. Les deux peintres y trouvent la lumière éclatante du sud de la France, celle qui avait envouté Matisse et Derain, réminiscence des voyages du jeune homme avec sa mère. Bercée par la méditerranée et sa douce chaleur, la couleur irradie les toiles de Friesz. L’arabesque dans le dessin d’une végétation luxuriante, la stylisation des formes, éradiquent les éléments descriptifs illusionnistes pour ne livrer que l’essentiel : des paysages flamboyants, lyriques, dont la force chromatique éclate. Ça y est, Othon Friesz est fauve.
« C’est brusquement, (…) à La Ciotat, sur le motif, que je m’aperçus qu’un cerne laqué était né, inscrivant la colline d’une ligne. J’étais revenu au dessin instinctivement, par nécessite picturale. J’avais rappris le dessin par moi-même, senti le dessin, ce que n’avaient pu m’enseigner ni les maîtres, ni les antiques. Un art plus grave me ramenait au style, fait de cadences et de rythmes » raconte le peintre. (Othon Friesz, cité dans F. Fels, L’Art vivant, de 1900 à nos jours, Genève, Pierre Cailler, 1950)
Cette même année l’artiste expose une quarantaine de toiles chez le marchand Druet avec qui il signe un contrat d’exclusivité. Lors de leur retour à Paris Braque se rapproche de plus en plus de Picasso et de ses théories cubistes. Friesz, lui, semble de nouveau tracté par le passé et ceux qu’il admire tant. L’influence de Cézanne, portée par une structure solide, l’énergie de la ligne et de forts contrastes devient dominante. A l’approche de la Première Guerre Mondiale, sa palette s’assombrit progressivement avec des tonalités de bruns, verts et bleus.
Le succès d’Othon Friesz se prononce avec des expositions non plus seulement en France chez Druet et au Salon des Indépendants ainsi qu’au Salon d’automne de Paris, mais également au Salon de la Toison d’or et au Salon du Valet de carreau à Moscou puis à Londres lors de l’exposition « Manet and the Post-Impressionists », à l’Armory Show de New York, la Galerie Cassiner de Berlin, à Saint-Pétersbourg, Düsseldorf, Cologne, Amsterdam, Leipzig, Prague, Bruxelles et enfin Munich. Cependant le début de la Première Guerre Mondiale ralentit cette fulgurante ascension internationale.
En 1914, le peintre fait une rencontre déterminante et construit une amitié durable avec Léon Pédron, riche négociant en café. L’homme d’affaire demande à Friesz, artiste désormais réputé, de gérer sa collection et lui achète une partie importante de sa production. Cette collaboration met l’artiste à l’abri du besoin et lui permet de mener une vie aisée d’artiste reconnu. Soucieux de son développement commercial, Friesz met fin à son contrat d’exclusivité avec Druet. Le peintre se rapproche d’Emile Bernard et Maurice Denis, avec qui il défend fervemment l’héritage de Cézanne.
En 1919 Pédron crée « Les Amis de la peinture moderne » afin de soutenir financièrement l’œuvre de Friesz. L’artiste est promu chevalier en 1925, officier en 1933 et enfin commandeur de la légion d’honneur en 1938.
A la mort de Pédron, c’est Katia Granoff de la galerie éponyme qui devient le mécène principal de Friesz. Dans la dernière période de sa vie, l’art du peintre se fait de plus en plus classique, dépourvu de recherches nouvelles et d’avancées plastiques.
Le 10 janvier 1949 Emile Othon Friesz meurt à Paris.